
La condition ouvrière
L’avènement du machinisme n’a pas amélioré suffisamment la condition ouvrière. Au lieu de donner aux ouvriers, outre du temps libre, de l’argent pour ce temps libre, on a choisi la surproduction qui a conduit à la crise et à la guerre.
« C’est une pitoyable histoire que celle des lois dites “sociales” de la Troisième République. Elles n’ont pas relevé la condition ouvrière, elles n’ont pas abaissé la féodalité capitaliste, elles ont plus qu’à demi ruiné l’économie nationale…
On ne peut faire disparaître la lutte des classes qu’en faisant disparaître les causes qui ont dressé ces classes les unes contre les autres. Ces causes, c’est la menace du chômage, c’est l’angoisse de la misère qu’elle fait peser sur vos foyers, c’est le travail sans joie de l’ouvrier sans métier, c’est le taudis dans la cité laide où il passe les hivers sans lumière et sans feu. C’est la vie de nomade sans terre et sans toit. Telle est la condition prolétarienne. Il n’y a pas de paix sociale tant que durera cette injustice. »
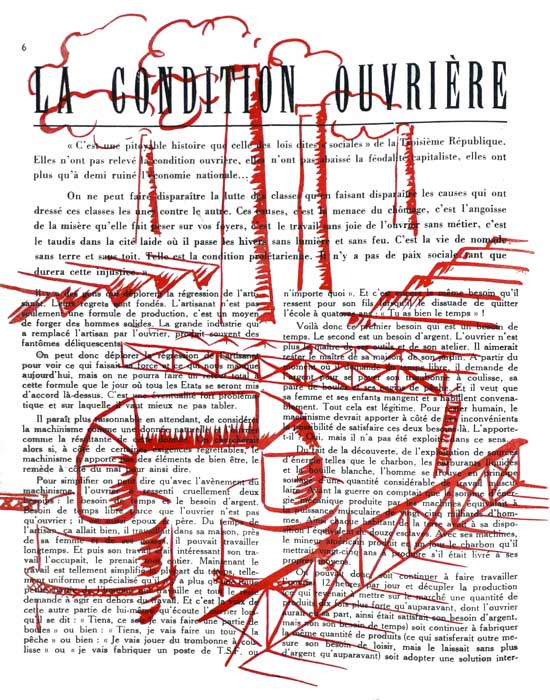
- Fac-similé de la première page de l’article
Il y a des gens qui déplorent la régression de l’artisanat. Leurs regrets sont fondés. L’artisanat n’est pas seulement une formule de production, c’est un moyen de forger des hommes solides. La grande industrie qui a remplacé l’artisan par l’ouvrier produit souvent des fantômes déliquescents.
On peut donc déplorer la régression de l’artisanat pour voir ce qui faisait sa force et ce qui nous manque aujourd’hui mais on ne pourra faire un retour total à cette formule que le jour où tous les états se seront mis d’accord là-dessus. C’est une éventualité fort problématique et sur laquelle il vaut mieux ne pas tabler.
Il paraît plus raisonnable en attendant de considérer le machinisme comme une donnée naturelle et l’ouvrier comme la résultante de cette donnée. On chercherait alors si, à côté de certaines exigences regrettables, le machinisme n’apporte pas des éléments de bien-être, le remède à côté du mal, pour ainsi dire.
Pour simplifier, on peut dire qu’avec l’avènement du machinisme, l’ouvrier a ressenti cruellement deux besoins : le besoin de temps et le besoin d’argent. Besoin de temps libre parce que l’ouvrier n’est pas qu’ouvrier ; il est aussi époux et père. Du temps de l’artisan, ça allait bien, il travaillait dans sa maison, près de sa femme et de ses enfants, il pouvait travailler longtemps. Et puis son travail était intéressant, son travail l’occupait, le prenait tout entier. Maintenant, le travail est tellement simplifié la plupart du temps, tellement uniforme et spécialisé qu’il n’y a plus qu’une toute petite partie de l’homme qui travaille et tout le reste demande à agir en dehors du travail. Et c’est la voix de cette autre partie de lui-même qu’écoute l’ouvrier lorsqu’il se dit : « Tiens, ce soir, je vais faire une partie de boules » ou bien « Tiens, je vais faire un tour à la pêche » ou bien « Je vais jouer du trombone à coulisse » ou « Je vais fabriquer un poste de T.S.F. » ou n’importe quoi. Et c’est encore le même besoin qu’il ressent pour son fils lorsqu’il le dissuade de quitter l’école à quatorze ans : « Tu as bien le temps ! »
Voilà donc ce premier besoin qui est un besoin de temps. Le second est un besoin d’argent. L’ouvrier n’est plus le maître de ses outils et de son atelier. Il aimerait rester le maître de sa maison, de son jardin. À partir du moment où il demande du temps libre, il demande de l’argent pour se payer son trombone à coulisse, sa paire de boules et ses engins de pêche. Et il veut que sa femme et ses enfants mangent et s’habillent convenablement. Tout cela est légitime. Pour rester humain, le machinisme devrait apporter, à côté de ses inconvénients, la possibilité de satisfaire ces deux besoins là. L’apporte-t-il ? Oui, mais il n’a pas été exploité dans ce sens.
Du fait de la découverte, de l’exploitation de sources d’énergie telles que le charbon, les carburants liquides et la houille blanche, l’homme se trouve en principe soulagé d’une quantité considérable de travail musculaire. Avant la guerre on comptait que la somme d’énergie mécanique produite par les machines équivalait à la puissance musculaire de vingt-cinq milliards d’hommes. Ainsi, chaque habitant de la Terre avait à sa disposition l’équivalent de douze esclaves. Avec ses machines, le mineur américain produit en un jour le charbon qu’il mettrait vingt-cinq ans à produire s’il était livré à ses propres moyens.
On pouvait donc soit continuer à faire travailler l’ouvrier douze heures par jour et décupler la production ce qui revenait à mettre sur le marché une quantité de produit dix fois plus forte qu’auparavant dont l’ouvrier aurait eu sa part (ainsi était satisfait son besoin d’argent mais non son besoin de temps), soit continuer à fabriquer la même quantité de produits (ce qui satisferait outre mesure son besoin de loisir, mais le laisserait sans plus d’argent qu’auparavant), soit adopter une solution intermédiaire : augmentation raisonnable de la production et diminution raisonnable du nombre d’heures de travail.
Ce double avantage possible du machinisme, les ouvriers n’en ont pas profité ou presque pas. On a un peu augmenté le pouvoir d’achat, on a un peu augmenté le temps libre. Mais si peu ! Pourtant les machines sont là qui tournent et qui broient les mains des étourdis, cassent les oreilles de ceux qui travaillent alentour et enfument tout le monde. Leurs avantages sont moins apparents. On ne voit pas si bien où s’en va le bénéfice de tout ce travail qu’elles font. En tout cas, celui qui les fait tourner ne voit pas bien. Il se demande où part tout ce boni. Il se demande si la répartition est équitable.
Dans la plupart des cas, le boni est utilisé par les financiers à l’installation de nouvelles entreprises qui leur fourniront de nouveaux bénéfices. La production croissant sans que croisse le pouvoir d’achat des masses ouvrières, les produits ne s’écoulent plus, on a une crise. Plutôt que d’avoir diminué uniformément le temps de travail de l’ouvrier en augmentant uniformément son pouvoir d’achat, on est amené à payer des gens à ne rien faire pendant que d’autres travaillent trop. La crise prouve qu’on n’a pas su tirer de la machine le parti qu’il fallait. Une plus juste répartition des produits du travail, en assurant plus de dignité à la vie de l’ouvrier, aurait empêché la création d’entreprises inutiles et, par là, évité la surproduction.
Pourquoi cela ne s’est-il pas fait ? La faute incombe aux financiers, manieurs d’argent sans contact avec les travailleurs. Leur égoïsme les a poussés à chercher dans la guerre un débouché factice à leurs produits, débouché d’autant plus important qu’en poussant le pays à une politique arrogante, ils se faisaient en même temps des clients dans les autres pays, légitimement soucieux de ne pas se laisser distancer.
C’est dans cet aspect international du problème que gît la difficulté. Un état doit concilier le bien-être et la sécurité des citoyens. Que dirait-on en effet d’une nation où la vie serait un paradis, qui refuserait toute dépense d’armement mais qui d’autre part serait menacée par une nation guerrière attendant seulement une occasion propice pour la réduire à l’esclavage ?
Dans l’état encore inorganisé de la communauté des peuples, et tant qu’on n’aura pas établi la paix sur des institutions internationales solides et sur une réforme des idées, la force des états restera la condition du bien-être des individus, et la force de la cité, c’est le travail des citoyens.
[/R.V./]